
Publié d’abord en anglais en 1968 sous le titre “The beautiful ones are not yet born”, le roman d’Armah, paru chez Présence Africaine en 1976, décrit la désillusion et la déception des peuples africains trahis par leurs élites soumises, pieds et poings liés, à un Occident prédateur et dominateur. Pour parler comme feu Umberto Eco, c’est un roman qui “met en scène le désarroi contemporain”, une critique féroce de la société ghanéenne gangrénée par la corruption et le matérialisme après l’indépendance politique arrachée aux Britanniques en 1957 par Kwame Nkrumah et d’autres.
Armah nous fait voir effectivement des personnages qui n’ont pas d’autre ambition que de s’enrichir rapidement et de jouir des biens matériels acquis de façon malhonnête. Le ministre Koomson fait partie de ces Ghanéens corrompus et jamais fatigués d’amasser et d’en mettre plein la vue aux autres. Mais, comme tout a une fin ici-bas, le gouvernement auquel il appartient finit par être renversé par des militaires. Koomson passe alors de l’opulence à la déchéance, de la blancheur des draps à l’obscurité dans les latrines des quartiers populaires. Pire encore, il n’a plus de maison et est obligé de vivre chez son ancien camarade de classe que l’auteur appelle tout simplement l’Homme (The Man).
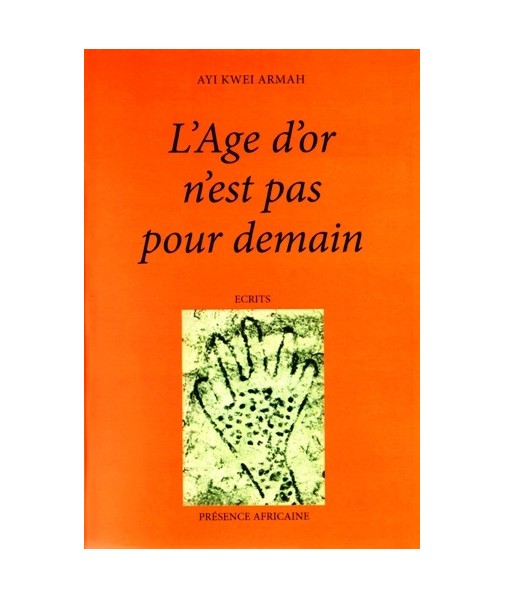 Ce dernier est désigné ainsi, peut-être parce qu’il est un des rares personnages du roman à incarner la salubrité, la rectitude morale, la dignité dans la pauvreté. De fait, l’homme mène une vie simple. Travaillant à la Ghana Railway Corporation de Takoradi et n’ayant pas les moyens d’habiter dans un quartier huppé, il aurait pu faire comme beaucoup de petits et grands fonctionnaires, c’est-à-dire piquer dans les caisses de l’État, extorquer de l’argent aux citoyens ayant besoin d’un service. Mais lui préférait se contenter de son salaire. Un salaire jugé insuffisant par sa femme Oyo et sa belle-mère portées sur le matériel et rêvant d’une meilleure vie que cette misère dans un quartier sale et pauvre. Leurs plaintes et critiques le conduisent quelquefois à douter du choix qu’il a fait mais rien ne réussit à détourner l’homme de ses convictions. Pour lui, ceux qui possèdent la puissance de l’aigle et son vol rapide devraient poursuivre leur vol. Quant à lui, il suivrait son lent chemin “sans bruit ni hâte”, même s’il a de plus en plus de mal à justifier sa propre honnêteté que certains autour de lui considèrent comme une lâcheté et une idiotie. Koomson et d’autres corrompus, eux, voulaient tout et tout de suite ; ils étaient pressés de faire fortune et de monter dans l’échelle sociale. Et pourtant, le peuple comptait sur eux pour améliorer un tant soit peu son existence. C’est ce peuple désabusé et amer qui s’exprime à travers les interrogations de l’homme : “ Est-il donc vrai que, derrière tous les beaux discours, les gens ne visent qu’à cela ? Il n’ y a donc pas de différence. Pas de différence entre Blancs et les singes qui les imitent, les hommes de loi et les marchands, et maintenant les singes qui imitent les singes, les hommes du Parti. Et, quand leur règne sera fini, il n’y aura pas de différence non plus. Tous les hommes nouveaux seront comme les anciens. Est-ce donc cela la vérité ? ” Le héros poursuit : “Comment Koomson peut-il revenir chez nous ? Que peut-il trouver à dire à ceux avec qui il travaillait autrefois ? Viendra-t-il voir ces fantômes qu’il a laissés derrière lui, sans dire un mot ? Peut-il venir s’asseoir avec ses anciens compagnons pour fumer l’herbe et maudire les juges stupides qui jettent en prison des hommes qui n’ont fait de mal à personne ? Koomson est souvent venu ici, mais comme un Blanc ou un notable.”
Ce dernier est désigné ainsi, peut-être parce qu’il est un des rares personnages du roman à incarner la salubrité, la rectitude morale, la dignité dans la pauvreté. De fait, l’homme mène une vie simple. Travaillant à la Ghana Railway Corporation de Takoradi et n’ayant pas les moyens d’habiter dans un quartier huppé, il aurait pu faire comme beaucoup de petits et grands fonctionnaires, c’est-à-dire piquer dans les caisses de l’État, extorquer de l’argent aux citoyens ayant besoin d’un service. Mais lui préférait se contenter de son salaire. Un salaire jugé insuffisant par sa femme Oyo et sa belle-mère portées sur le matériel et rêvant d’une meilleure vie que cette misère dans un quartier sale et pauvre. Leurs plaintes et critiques le conduisent quelquefois à douter du choix qu’il a fait mais rien ne réussit à détourner l’homme de ses convictions. Pour lui, ceux qui possèdent la puissance de l’aigle et son vol rapide devraient poursuivre leur vol. Quant à lui, il suivrait son lent chemin “sans bruit ni hâte”, même s’il a de plus en plus de mal à justifier sa propre honnêteté que certains autour de lui considèrent comme une lâcheté et une idiotie. Koomson et d’autres corrompus, eux, voulaient tout et tout de suite ; ils étaient pressés de faire fortune et de monter dans l’échelle sociale. Et pourtant, le peuple comptait sur eux pour améliorer un tant soit peu son existence. C’est ce peuple désabusé et amer qui s’exprime à travers les interrogations de l’homme : “ Est-il donc vrai que, derrière tous les beaux discours, les gens ne visent qu’à cela ? Il n’ y a donc pas de différence. Pas de différence entre Blancs et les singes qui les imitent, les hommes de loi et les marchands, et maintenant les singes qui imitent les singes, les hommes du Parti. Et, quand leur règne sera fini, il n’y aura pas de différence non plus. Tous les hommes nouveaux seront comme les anciens. Est-ce donc cela la vérité ? ” Le héros poursuit : “Comment Koomson peut-il revenir chez nous ? Que peut-il trouver à dire à ceux avec qui il travaillait autrefois ? Viendra-t-il voir ces fantômes qu’il a laissés derrière lui, sans dire un mot ? Peut-il venir s’asseoir avec ses anciens compagnons pour fumer l’herbe et maudire les juges stupides qui jettent en prison des hommes qui n’ont fait de mal à personne ? Koomson est souvent venu ici, mais comme un Blanc ou un notable.”
Certains auteurs comme Chinua Achebe ont reproché à Armah de donner de l’Afrique “une image erronée, malsaine et nihiliste”. D’autres le jugent pessimiste. Certes, la pourriture est omniprésente dans ce roman (pourriture des latrines, pourriture des choses, pourriture des corps, etc.) mais, si l’auteur a choisi cette écriture scatologique, c’est justement pour mieux souligner la pourriture morale de ceux dont la nation attendait beaucoup mais qui ont montré, aussitôt après avoir été formés aux frais de l’État, qu’ils n’étaient rien d’autre que des jouisseurs égoïstes. Armah veut nous dire que ce sont ces élites médiocres et superficielles qui poussent certains à considérer l’Afrique comme une “immense caverne ténébreuse où viendraient se brouiller tous les repères et toutes les distinctions, et se dévoileraient les failles d’une histoire humaine tragique et malheureuse” (Achille Mbembe, “De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine”, Karthala, 2000).
Armah pessimiste ? Il m’est difficile de souscrire à un tel jugement car, si le héros, l’homme, refuse jusqu’au bout de pactiser avec la pourriture, cela signifie que l’auteur reste optimiste pour l’Afrique et qu’il garde l’espoir que ce continent peut produire encore des hommes et femmes capables de résister à l’argent facile et malhonnête.
Disciple et fils spirituel de Frantz Fanon, Armah est un des grands noms de la littérature africaine d’expression anglaise. Après avoir travaillé en Algérie, en France, en Tanzanie, au Lesotho et aux États-Unis, il vit actuellement au Sénégal.
Jean-Claude DJEREKE





