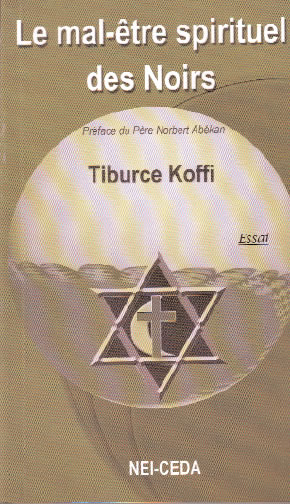Réflexions autour de la libération spirituelle des Africains
Pauvre Afrique ! Si au moins ses douleurs actuelles pouvaient être celles d’un enfantement », lit-on dans « Le coup de vieux(1) » de Sony Labou Tansi et Kaya Makhélé. En filigrane, le propos dit les tourments auxquels le continent noir est en proie depuis des décennies — des siècles même, quand nous promenons le regard sur l’histoire de l’Afrique, celle de l’Afrique Noire surtout : guerres tribales, esclavage, traître négrière, colonisation, néo colonisation, mal gouvernance, luttes sanglantes et insensées pour la conquête ou la préservation du pouvoir politique, etc. ; autant de désespérances à mettre dans le lot de malheurs qui ont frappé et continuent de frapper les Africains depuis les époques les plus reculées de leur histoire, jusqu’aujourd’hui, au point où les plus exigeants d’entre nous diraient que l’Afrique n’a pas encore dépassé l’âge des déraisons. Bien sûr que ce ne sont pas les exégèses qui ont manqué pour diagnostiquer le mal africain, depuis le temps des alarmes (justifiées) de René Dumont jusqu’à celui des consciences critiques d’aujourd’hui. Et, apparemment, rien ne semble nous permettre de croire que les choses iront mieux ; rien, sinon l’optimisme béat et sans raison du croyant. Et pourtant, et pourtant, il faut que les choses changent — nous sommes tous d’accord là-dessus : « Il faut que les choses changent ». Nous savons ces choses que nous devons changer. Dès les années 1990, une appellation a été promue pour désigner ces choses qui doivent changer : « la mal gouvernance ». On en connaît, tous, le contenu : le tribalisme, le népotisme, la corruption galopante, l’impunité, le culte du désordre, de l’indiscipline, la fragilité de nos élites face au pouvoir de l’argent, l’obsession du pouvoir, etc. On avait appelé cela, notre « inadaptation à la modernité », ou bien notre « difficulté de concilier tradition et modernité ». Les plus intellectualisés d’entre nous avaient alors dit que pour soigner le mal africain, il fallait qu’on procède à une « reconversion des mentalités » — la belle et savante expression ! Et lorsqu’on avait fini de dire cela, on avait cru qu’on était désormais bien partis pour guérir l’Afrique de ses maux. Reconvertir les mentalités ! Mais à quoi fallait-il (ou faut-il) les reconvertir ? Aux exigences de la modernité, du développement, bien sûr. Questions appropriées toutefois : et si, en réalité, le problème était plus profond que cela ? Et si, en réalité, c’était l’Afrique elle-même qui refusait le développement ? — comme l’avait si audacieusement pensé Axelle Kabou dans son fameux livre(2) qui a effarouché l’intelligentsia africaine ? Mais aussi, comment penser un seul instant que tout un continent, toute une race, au risque de choisir la voie du suicide, puisse refuser ce qu’on appelle « le développement » et secréter consciemment les germes de sa propre destruction ? Comment croire que l’Afrique puisse refuser le développement — concept qui, dans les faits, désigne seulement une manière d’organiser la vie sociale, de sorte à procurer au citoyen, le maximum d’aise, de bien-être ? Pouvoir se soigner, se déplacer, se nourrir, se vêtir, s’instruire ; pouvoir donner librement son opinion sur les problèmes de la cité, avoir du travail, participer en conscience libre au mouvement et à l’histoire de sa société, la faire prospérer, réduire le taux de misère, discipliner le peuple… Non, il semble inimaginable que l’Afrique puisse refuser le développement ! Soit ! Mais alors, qu’est-ce qui explique cette incapacité d’organiser au mieux la vie de leurs peuples, qu’affichent la plupart des dirigeants africains ? Qu’est-ce qui explique ‘‘l’échec africain’’ dans la course au développement (ou la marche vers le développement — entendu qu’on n’est pas tous obligé de courir ?). Si le cadre étroit d’un article ne peut se donner la prétention de faire le diagnostic complet du mal africain, il peut cependant en dire quelques mots.
Inventaire des causes
Pendant longtemps — l’attitude n’a guère changé —, l’accent a été mis sur trois causes fondamentales qui expliqueraient le retard de l’Afrique : la traître négrière, la colonisation, la néo colonisation. La première (la traître négrière) occupe la première place dans l’inventaire de ces causes ; elle ne semble pas avoir démérité cette place : en dépeuplant le continent de ses bras valides pendant des siècles, la traître négrière a en effet fortement handicapé le continent africain au profit de l’Occident. La richesse capitaliste a indiscutablement une grande part de fondation noire. La colonisation, en soumettant l’Afrique au joug de la force militaire et à l’exploitation tous azimuts de ses richesses, a prolongé son agonie. La néo colonisation a hypothéqué son éveil. Les Africains peuvent alors et en toute légitimité, dire que c’est l’Europe capitaliste et impérialiste qui est à la cause de leur retard. Thèse que n’hésite pas à combattre Stephen Smith dans le ton provocateur qu’on lui connaît ; on sait que, pour ce journaliste essayiste, la traître négrière, la colonisation et la néo colonisation ne sont pas les causes du retard de l’Afrique ; elles en sont les conséquences. « C’est parce que l’Afrique était faible qu’elle a été colonisée », affirme-t-il hautement dans son livre au titre impudique : Négrologies. L’argument paraît difficilement réfutable ; dans tous les cas, on remplirait des pages entières pour porter la contradiction à Stephen Smith que nous ne répondrions pas pour autant à la question fondamentale : comment sortir le continent africain du sous développement et de la dépendance économique et politique qui le caractérisent ? Moins évasif que bon nombre d’intellectuels africains sur la question, l’écrivain ivoirien Jean-Marie Adiaffi a proposé dans deux de ses livres (« Silence, on développe » et « Les naufragés de l’intelligence », des solutions au mal africain. Pour cet écrivain qui avait ‘‘l’Afrique dans la peau’’, le continent noir se doit de réaliser une série de révolutions pour sortir de son état de dépendance et accéder à la libération ; entre autres : une révolution scientifique et technologique, une révolution culturelle, une révolution spirituelle, etc. L’œuvre de Jean-Marie Adiaffi apparaît ainsi comme un vaste exposé sur la problématique de la libération de l’Afrique(3
Problématique de la libération
De toutes les révolutions que propose Jean-Marie Adiaffi, celle qui m’a toujours paru essentielle, est la révolution spirituelle ; il m’a semblé raisonnable d’en faire un pendant de la révolution culturelle qui fut une des charpentes sérieuses et décisives de la pensée et l’action de Mao Tsé Toung. Sur cette question, l’interrogation qui nous vient immédiatement à l’esprit est celle-ci : Et si, au-delà de toutes les exégèses savantes qui ont été développées sur le mal de l’Afrique, les sources du sous-développement du continent se trouvaient dans la mauvaise gestion de sa spiritualité ? Voilà en effet un continent dont la vie spirituelle (la plus perceptible, parce que spectaculaire) est totalement empruntée aux peuples conquérants qui l’ont soumis : le christianisme et l’Islam (les deux religions les plus présentes sur le continent) sont effectivement des religions étrangères ; mieux (ou pis), des religions de conquête, et donc de domination. Les armes ont signé la défaite militaire de l’Afrique, le christianisme et l’islam marquent sa capitulation spirituelle. Les canons ont contraint les corps, les religions ont capturé l’âme des vaincus. Oui, en assistant à l’assujettissement spirituel de son peuple par les pasteurs blancs, le héros de Chinua Achebe (Things fall apart) a raison de dire que « Le monde s’effondre ». La pire des défaites qui puisse consacrer l’anéantissement d’un peuple, est sa capitulation spirituelle. Et nous pensons qu’une des causes profondes et pertinentes du ‘‘retard’’ de l’Afrique, est sa capture culturelle par la langue et la religion du conquérant. Les difficultés qu’expose le continent noir à se ‘‘réveiller’’ ont certainement leurs origines dans le ‘‘pathos spiritus’’ dans lequel baignent les pays africains (surtout ceux du Sud du Sahara). Pris en effet entre l’attachement presque atavique à l’humanisme animiste ou bossoniste (concept ‘‘adiaffien’’) et les tentatives difficiles, très difficiles, d’appropriation ou d’inculturation des humanismes islamique et ‘‘christianiste’’, les Africains se retrouvent dans les tenailles d’une spiritualité floue, désordonnée et finalement peu apte à répondre à leurs angoisses métaphysiques et à résoudre les multiples contradictions que les défis de la modernité dressent sur leur parcours. A la question du salut des âmes, l’Asie répond par les réponses pensées par Bouddha ; les peuples du monde arabe et du Moyen Orient, par les enseignements de Mahomet ; l’Occident, par ceux de Jésus-Christ. Et les Africains ?… Ballotté entre les résidus de l’animisme (qui, par manque de penseurs et de théoriciens, n’a jamais su renouveler ses cultes) et les enseignements (pas toujours bien compris — parce que étrangers à leurs expériences du monde) du christianisme et de l’islam, l’Africain passe de sectes en sectes, de pratiques cultuelles en pratiques cultuelles, sans réelle base spirituelle. Le résultat de tout cela donne un peuple fragile, désorienté, manquant de ressorts intérieurs, éprouvant de la gêne, sinon de la honte à assumer son propre héritage spirituel qu’il tente de camoufler dans les pratiques cultuelles imposées par ceux qui l’ont soumis : tout bon chrétien a son crucifix ou une représentation de la Vierge Marie accroché (e) à un mur de sa maison (ou de son bureau), son chapelet qu’il égrène avec une furieuse ferveur en récitant les versets de la bible ou du coran. Ces objets le rassurent dans sa tentative d’accéder au divin ; par eux, il se sent lié au sacré. Mais ces mêmes africains chrétiens et/ou musulmans, vous diront que les perles de la prêtresse komian ou la statue que la grand-mère garde au chevet du tara sont des œuvres du démon ! Des amulettes sur lesquels ils jettent de la suspicion et un mépris souverain ; cette suspicion et ce mépris que le pasteur, le prêtre ou le grand Imam du quartier leur ont appris à jeter sur les objets cultuels de représentation hérités de leur vraie tradition religieuse. Les Africains chrétiens ou musulmans ont du mal à accepter que le chapelet soit une amulette ; or il l’est en effet. Ils ont du mal à comprendre que le crucifix (parce qu’il n’est qu’un objet en lequel le croyant a investi un pouvoir) est lui aussi, sur le strict plan définitionnel, une amulette ; c’est-à-dire un objet qui nous sert de médium entre nous et le divin. Cette disposition d’esprit débouche souvent sur des comportements naïfs, voire ridicules, que l’on retrouve même chez les plus ‘‘ évolués’’ d’entre nous : hautes personnalités politiques, intellectuels de renommée, hauts cadres de l’administration, etc. Par exemple : les chrétiens africains font le pèlerinage en Israël ou à Lourdes pour y ramener de… l’eau. On leur a fait croire (et ils croient effectivement en cela) que c’est de l’eau bénite. Ces mêmes chrétiens africains refusent de croire que Dieu ait pu bénir l’eau de la rivière sacrée de leur village, et que les ancêtres ont sublimée depuis des siècles ! Demandez-leur d’aller prendre aussi un peu de cette eau sacrée de leur village pour venir en ville, ils vous traiteront de démon ! Demandez-leur de prier Dieu en se servant du collier de perles (c’est bel et bien un chapelet bossoniste) ou des cauris de la komian ; ils vous regarderont d’un regard suspicieux, mauvais et farouchement désapprobateur. Parce que le maître blanc ou arabe leur ont appris que ces objets cultuels hérités de leur culture la plus authentique, sont des œuvres du démon ! L’Afrique spirituelle, à leurs yeux, doit être chrétienne ou musulmane ou mahikariste, ou une de ces religions venues d’Asie, qu’ils viennent de découvrir, et qui commencent à prospérer sur le continent noir… Mais pourquoi donc Dieu bénirait-il seulement l’eau des autres (…) et non pas aussi nos eaux à nous ? Pour quelle raison ferait-Il de la discrimination entre les eaux ? (…) Que gagne Dieu à disqualifier nos eaux ? Pourquoi ? Les mains des artisans qui fabriquent les statues marchandes de la Vierge Marie sont-elles plus pures que celles des artisans de nos villages qui ont créé les statues que nos ancêtres ont vénérées et que nous avons rejetées parce que les conquérants, ceux (qui nous ont vaincus) nous ont dit que c’étaient des objets maléfiques ? Poussons la série d’interrogations jusqu’au bout : pourquoi donc serait-ce à eux seuls que le Grand maître de l’Univers, celui-là qui est au commencement de tout et par qui toute Justice est possible, révélerait Sa Parole, et non pas à nous aussi, peuples noirs ? Nous qui, par l’animisme, avons su véritablement décréter Son omniprésence (dans l’air, le feu, l’eau, le souffle du vent, ‘‘le buisson en sanglot4’’, etc.) ? Sommes-nous coupables à ses yeux de n’avoir inventé ni le canon ni la poudre ?… Un peuple qui se renie, jusqu’à sa propre spiritualité, peut-il survivre aux agressions extérieures ? Notre réponse est sans équivoque : non ! On le voit : c’est à une véritable opération d’ajustement spirituel que devront s’atteler les Africains, s’ils veulent sortir de leur état de dépendance choquante. Car un peuple sans spiritualité propre est un peuple fragile, ouvert à tous les échecs, et livré aux fantaisies et appétits nocifs de tous les prédateurs.
Tiburce Koffi
Notes :
- Une pièce signée de Sony Labou Tansi et Kaya Makhélé et interprétée par La Compagnie didiga, à Abidjan et à Carthage au cours des années 1990, dans une mise en scène de Bernard Zadi.
- Conf. Et si l’Afrique refusait le développement ?
- C’est le sujet d’une thèse en cours que nous nous attelons à rédiger sur la production de cet écrivain.
- Fragment de vers emprunté à Birago Diop.
Source : La Dépêche d’Abidjan